la gouvernance émotionnelle, centrée sur la notion de plaisir comme finalité de nos actions.Nous sommes, en effet, « naturellement programmés » pour le plaisir. Plus souple que les deux premières gouvernances du mode automatique, la gouvernance émotionnelle est cependant limitée à sa fonction première (rechercher le plaisir et éviter le déplaisir) et n’a pas la capacité d’en sortir. Au sein de la gouvernance émotionnelle, l’ANC distingue trois types de contenants motivationnels. Le premier type est celui des motivations intrinsèques et inconditionnelles, qui nous poussent à agir pour le plaisir même que l’action nous procure, quel que soit son résultat. Les idéaux et les passions les illustrent. En ANC, ce type de contenants, sources de plaisir et d’énergie, est appelé « motivations primaires ». Ces motivations se sont forgées vraisemblablement au cours de notre gestation et des premiers mois de notre vie. Le second type est celui des motivations extrinsèques et conditionnelles, qui nous poussent à agir pour le plaisir que nous procure le résultat de l’action (pas l’action elle-même). Le plaisir attendu se transforme déplaisir si le résultat n’est pas à la hauteur de nos espérances (échec, manque de reconnaissance…). En ANC, ce type de contenants est appelé « motivations secondaires ». Elles se forgent pendant l’enfance puis évoluent, en fonction de ce que nous avons appris de la vie (notre éducation, notre culture, nos modèles, nos expériences personnelles…). Nos motivations secondaires se renforcent lorsque notre action rencontre le succès et/ou la reconnaissance, qui nous procurent de la satisfaction (plaisir). Dans le cas contraire, elles s’effritent, perdent de leur force, ou se rigidifient sous forme d’intolérances, d’aversions, de rejet… Dans les deux cas, les motivations secondaires sont coûteuses en énergie et empreintes de rigidité. Le troisième type est celui des motivations velléitaires dites « tertiaires », qui correspondent à des déclarations d’intention mais qui ne se concrétisent pas, ou si peu que pas. Les vœux pieux peuvent les illustrer. Enfin, la gouvernance émotionnelle recouvre des contenants correspondant à nos surinvestissements émotionnels. Ils apparaissent comme de très fortes motivations mais sont un prétexte inconscient pour chercher à atteindre un objectif caché (que nous ne nous autorisons pas à rechercher consciemment). L’expérience démontre que ces illusions de motivations ne sont réellement jamais satisfaites ni satisfaisantes. Elles se terminent très souvent en échec, engendrant chez nous une douleur amère et persistante. Cette gouvernance s’exprime essentiellement par une intensité émotionnelle de plaisir ou de déplaisir, de désir ou d’appréhension, voire de rejet. Le modèle ANC des dynamiques motivationnelles L’hypothèse de travail formulée par le Dr Jacques Fradin est que nos motivations (littéralement « ce qui nous met en mouvement, nous bouger ») se forgent à partir des états instinctifs de fuite, de lutte, d’inhibition et d’activation de l’action (calme), dépourvus de leur fonction d’urgence. Si un état instinctif a pu être satisfait dès son expression, sa modulation sera dite « réussie » et la motivation en construction tendra vers l’extraversion. Si ce n’est pas le cas, notre cerveau mobilisera de l’énergie pour satisfaire le besoin : la modulation de cet état instinctif sera dite « empêchée » et la motivation en construction tendra vers l’introversion. Qu’elles soient « réussies » ou « empêchées », ces modulations sont toutes positives puisqu’elles correspondent à une idéalisation d’un état perçu comme « bon » par le nourrisson à un moment donné : être calme (activation de l’action), être en mouvement (état de fuite), se mettre en colère et si besoin lutter (état de lutte), être inhibé, abattu (état d’inhibition). Ainsi, selon l’ANC, si le nourrisson a vu ses besoins comblés alors qu’il ne les exprimait pas encore (activation de l’action), il idéalisera le « tout est facile » (activation de l’action réussie = dynamique motivationnelle dite du « philosophe »). S’il ne les a pas encore exprimés mais les ressent proche, il idéalisera le « tout est réflexion » (activation de l’action empêchée = dynamique motivationnelle dite du « novateur »). Si le nourrisson les a exprimés par le mouvement (fuite) et que ses parents ont rapidement répondu à sa demande, il idéalisera le « tout est mouvement » (fuite réussie = dynamique motivationnelle de l’« animateur »). Si ses parents tardent et qu’il doit se débrouiller, gérer son problème seul, il idéalisera le « tout est gestion » (fuite empêchée = dynamique du « gestionnaire »). Si ses parents répondent à sa demande alors qu’il commence à s’énerver, à manifester de la colère (lutte), il idéalisera le « tous avec moi » (lutte réussie = le « stratège »). Si ne c’est pas le cas, il idéalisera le « tout est challenge » (lutte empêchée = le « compétiteur »). Si ses besoins ne sont toujours pas satisfaits, il passera en état d’inhibition et se mettra à pleurer). Dans le cas où ses parents répondent positivement à ses pleurs, il idéalisera le « tous ensemble » (inhibition de l’action réussie = dynamique motivationnelle dite du « participatif »). Dans le cas où ses parents interviennent selon leur perception du temps et non la sienne, le nourrisson idéalisera le « tout, d’abord pour les autres (et moi après) » (inhibition de l’action empêchée = le « solidaire »). Le nourrisson aurait tendance à reproduire tel ou tel comportement qui lui a permis d’obtenir satisfaction. Et si ses principaux besoins sont le plus souvent satisfaits de la même façon, les motivations correspondantes se fixeront « dans le marbre de sa personnalité » et deviendront ses motivations intrinsèques, inconditionnelles et inaltérables. Nous disposons de plusieurs motivations, pour le plus grand nombre d’entre nous. Par souci de simplification et en vue d’une mise en pratique rapide, le modèle des dynamiques motivationnelles a été ici volontairement simplifié. Et toujours par souci de simplification, nous pouvons résumer les motivations de la façon suivante :
En résumé, L’ANC propose un modèle basé sur 8 dynamiques comportementales :
Vous venez de lire le sixième extrait de cet article. Pour en découvrir la version complète, téléchargez gratuitement le PDF :
Les commentaires sont fermés.
|
AuteurPascal Vancutsem est spécialisé dans l’accompagnement de managers, de dirigeants et de personnalités pour la construction de leur stratégie personnelle. Archives
Juillet 2023
Categories
Tous
|
||||||
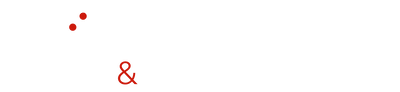
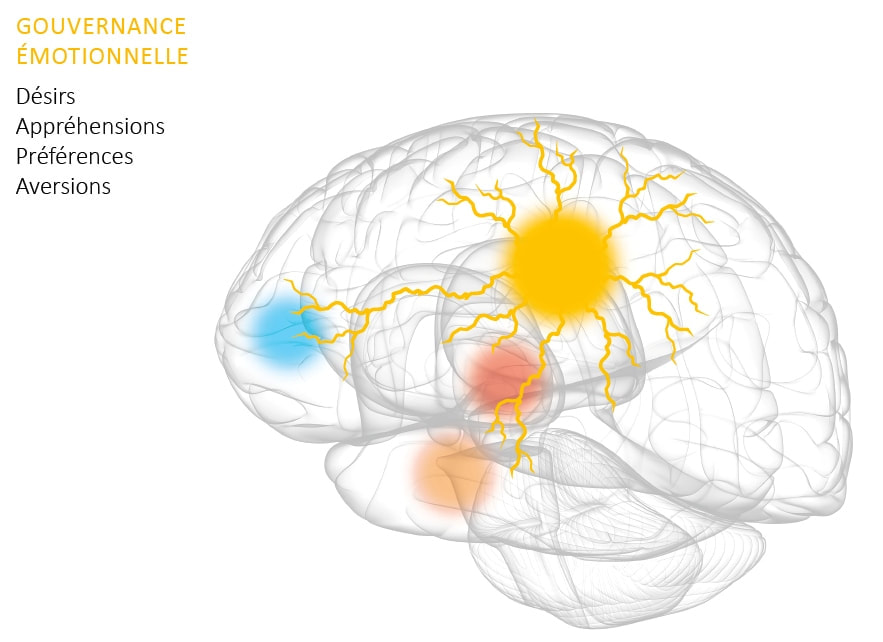

 Flux RSS
Flux RSS